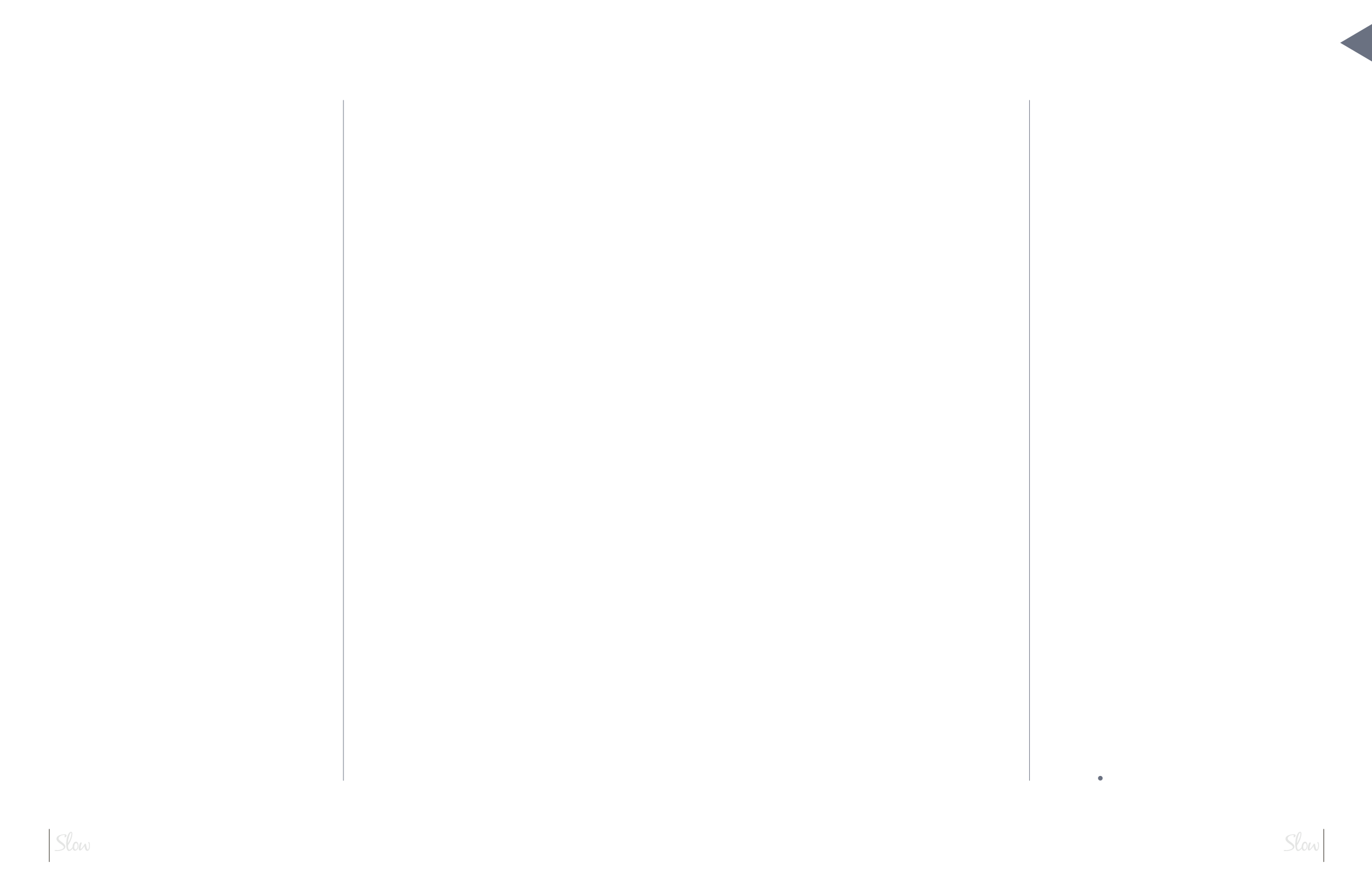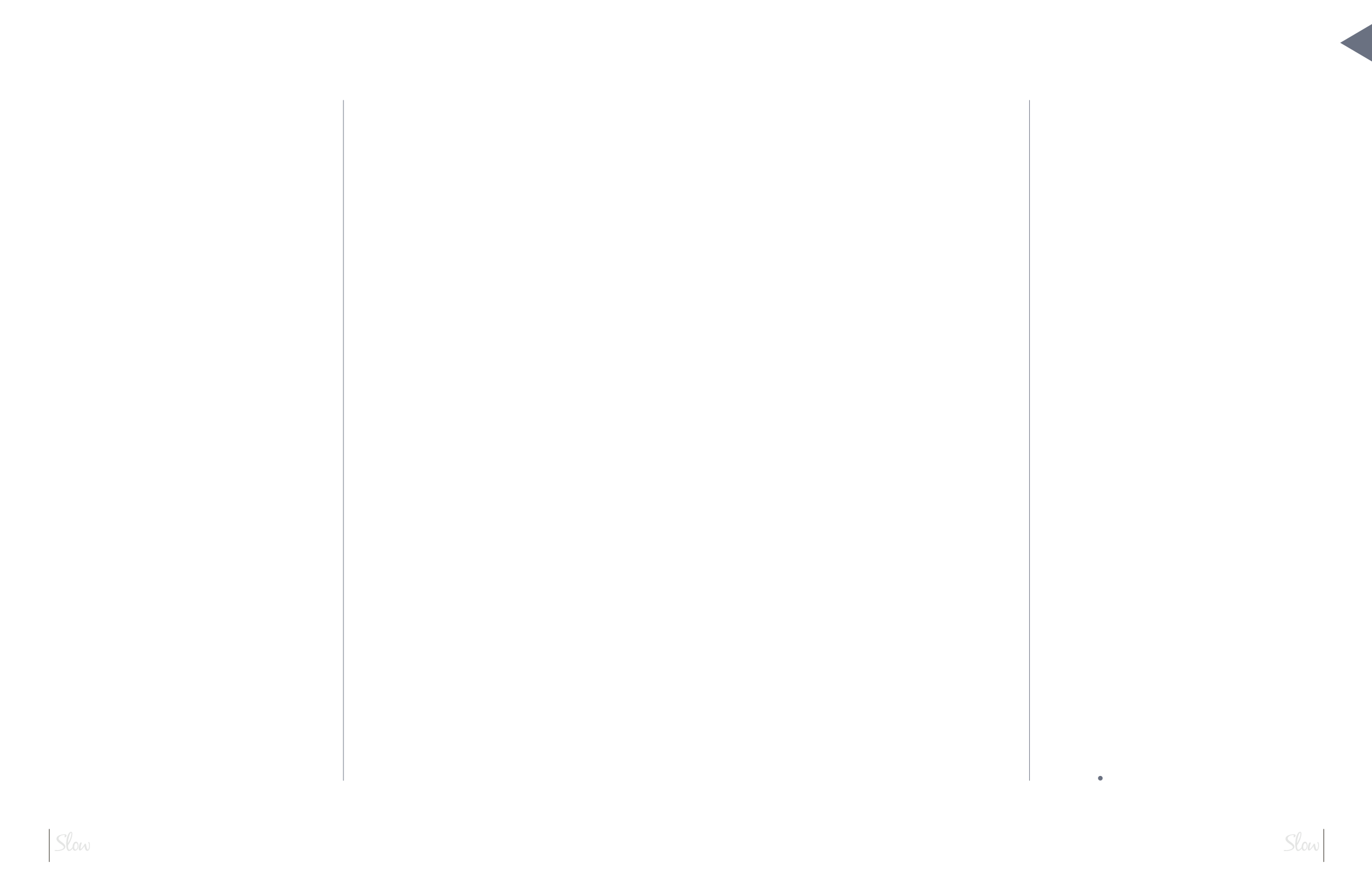
Pierre d’Elbée
Il y a cette phrase remarquable de Rocke-
feller « Si ton seul but est de devenir riche,
tu n’y arriveras jamais ». Je crois qu’elle est
vraie. L’âpreté au gain, l’exigence excessive
et cruelle vis-à-vis des personnes, l’esprit de
calcul systématique ne sont pas des condi-
tions optimales de performance, en tout
cas pas durables. Tôt ou tard, l’humain se
rebelle. Il a besoin de respirer avec des projets
rentables, mais aussi socialement utiles,
beaux, respectueux de la nature…
François de Montfort
Les recherches actuelles sur l’entreprise (voir
le livre d’Adélaïde de Lastic
Que valent les
valeurs
) montrent que l’on n’a pas d’un côté
des valeurs marchandes et matérielles, et de
l’autre des valeurs non marchandes, et imma-
térielles. Il n’y a pas l’économique et le non-
économique, deux zones de l’agir humain
avec une frontière « étanche ». Pour moi, les
éléments dits de gratuité sont constitutifs de
l’activité économique et ces éléments sont
même fondamentaux. On achète une qualité
de la relation, un conseil, un plus indéfinis-
sable qui fait tout le plaisir de donner que
de recevoir. Rendre complètement marchand
cette relation annihile le développement de
l’activité économique. Si l’on prolonge la
réflexion, cela veut dire que « l’économique
ne possède pas à son propre niveau la tota-
lité de sens et de finalité, mais une partie
seulement ». La finalité économique n’est pas
l’économie elle-même mais le développement
humain.
Pierre d’Elbée
Qu’est-ce qu’une valeur ? C’est un principe au
nom duquel on décide et on agit. L’entreprise
est d’abord fondée sur les valeurs utiles, parce
que le premier but subjectif du travail est de
pouvoir vivre de l’utilité que l’on produit et
que l’on vend. La performance, l’efficacité,
la rentabilité sont bien des valeurs fonda-
mentales d’entreprise. Toute la question est
de savoir si cet univers de valeurs utiles peut
exister de façon autonome, sans autre réfé-
rence. Or je ne le crois pas. Je crois même
que le capitalisme actuel, sous sa forme finan-
cière et cupide, est au fond un « tue l’entre-
prise ». Et c’est là que je suis d’accord avec
toi. Les valeurs de la performance sont invi-
vables sans être associées à celles de plaisir
et d’éthique. Les valeurs du plaisir apportent
aux hommes une respiration indispensable à
la tension du résultat et les valeurs éthiques
leur apportent la reconnaissance et la justice.
Ces univers de valeurs laissent pointer un
élément de gratuité : on ne travaille pas seule-
ment pour l’argent, mais aussi parce que l’on
aime être utile (plaisir) et on aime que cette
utilité serve à d’autres que soi-même. C’est
cela la gratuité, une attitude qui ne vise pas
d’abord ni seulement son intérêt propre.
Alors oui, il y a de la gratuité dans l’entre-
prise, dans la générosité d’un responsable qui,
par son comportement, sert autre chose que
son ambition personnelle. Il y a de la gratuité
dans le commercial qui cherche une transac-
tion juste, et pas seulement la plus rentable
possible. Il y a de la gratuité dans le travail de
n’importe quel salarié qui aime tout simple-
ment que son travail soit bien fait…
François de Montfort
Il existe une autre approche qui consisterait
à dire « il y a l’univers marchand de l’entre-
prise et l’univers de la gratuité dans le béné-
volat paré de toutes les qualités ». Il y a la
tentation un peu rationaliste de ranger les
univers dans des cases, aux dépens de l’unité
et de la vie qui mêle les choses. Il y a comme
on l’a vu, de l’économique dans le bénévolat
et du non économique dans le marchand.
J’irai plus loin en disant que la quantification
actuelle au niveau d’un pays, en particulier le
PIB, ne mesure pas le développement humain
ni le respect de la biosphère. L’ONU a mis
en place un indice de développement humain
(IDH) qui fait moins la une des journaux que
le PIB. La mesure quantitative ne suffit plus à
assurer l’accomplissement des finalités d’une
entreprise ou d’une économie.
Pierre d’Elbée
La rentabilité est une condition
sine qua non
de l’entreprise, pas d’une association carita-
tive. Il ne faut pas l’oublier. Cela ne veut pas
dire que l’association n’a pas besoin de perfor-
mance : le gaspillage est toujours possible,
toujours à éviter. Cela ne veut pas dire non
plus que l’entreprise n’a pas un besoin pressent
de répondre, par une prestation rentable,
à un besoin honnête, et mieux encore, à
se mettre au service d’un projet d’intérêt
commun, à forte incidence environnementale
et humaine. La culture du développement
durable est à ce titre la preuve qu’un horizon
de profit est insuffisant à développer une
économie saine. Il faut sortir de ce procès
d’intention bien français que l’on fait trop
volontiers au monde de l’entreprise, à savoir
que son activité est un prétexte au profit, et
que finalement seul le profit compte vraiment
pour elle. Il faut citer l’esprit de service, la
beauté des produits, la défense de compor-
tements éthiques et intègres qui peuvent
même aller parfois à l’encontre du lucratif
lui-même. Toute la question est de savoir si
ces éléments se surajoutent à l’activité écono-
mique ou s’ils la constituent. La performance
est l’œuvre d’acteurs, et ces acteurs peuvent
avoir des motivations variées. Certains très
intéressés, et d’autres pas du tout. La satisfac-
tion du travail bien fait, l’esprit de perfection,
la qualité, l’esprit de curiosité qui conduit à
l’innovation ne peuvent pas être considérés
comme purement utilitaristes.
François de Montfort
Derrière notre échange, je crois que l’on peut
dessiner ou redessiner un monde économique
dans lesquelles des valeurs de toujours s’affir-
ment avec une nouvelle force.
La qualité des relations interpersonnelles : la
performance n’est pas la somme des opéra-
tions individuelles, mais de la cohérence des
acteurs entre eux qui s’enrichissent de leur
diversité, complètent leurs fragilités, addi-
tionnent leurs points forts, créent un tout qui
dépasse les parties. Cette économie met en
valeur les comportements d’empathie et de
coopération. On ne sait plus qui a fait quoi
dans l’œuvre commune, ce qui n’empêche pas
la reconnaissance individuelle.
L’organisation en réseau: qui demande une vision
commune et la confiance entre ses membres,
mais qui donne une organisation adaptative et
flexible dans un contexte d’incertitude.
Le bien commun : peut-être est-on allé au bout
de notre individualisme et de la recherche
sans fin d’un épanouissement personnel. Il
est temps de cultiver le don dans une cause
commune, de définir un futur positif et juste
pour l’ensemble. Le développement de biens
communs gratuits (l’exemple de Wikipédia),
notre capacité à partager des biens par souci
d’économie, mais aussi pour ne pas gaspiller,
montrent qu’il y a sans doute une aspiration à
bâtir quelque chose de commun qui redonne
un élan et un plaisir d’être ensemble.
Pierre d’Elbée
Il y a un élément de gratuité que l’on
rencontre souvent dans les entreprises : c’est
la gratitude. Combien de fois j’ai entendu
des responsables me dire que s’ils avaient
aujourd’hui un poste de responsabilité, ou
s’ils étaient heureux dans leur travail, c’est
parce qu’ils avaient eu la chance d’œuvrer
sous les auspices d’un chef bienveillant, d’un
responsable attentif qui les avait accompa-
gnés dans leur progression. Sans lui, il est
clair qu’ils n’en seraient pas là où ils sont
aujourd’hui. La gratitude, c’est le sentiment
de reconnaissance que l’on ressent à l’égard
de quelqu’un qui nous a donné plus qu’on
ne pourra jamais lui rendre. C’est le merci
que l’on donne en signe de reconnaissance à
celui ou celle qui ne fait pas peser sur soi la
dette qu’en stricte justice, on lui doit. C’est
une attitude noble, gratuite. Elle existe. Je l’ai
rencontrée !
La gratitude, c’est
le sentiment de
reconnaissance que
l’on ressent à l’égard
de quelqu’un qui
nous a donné plus
qu’on ne pourra
jamais lui rendre
41
40
métier