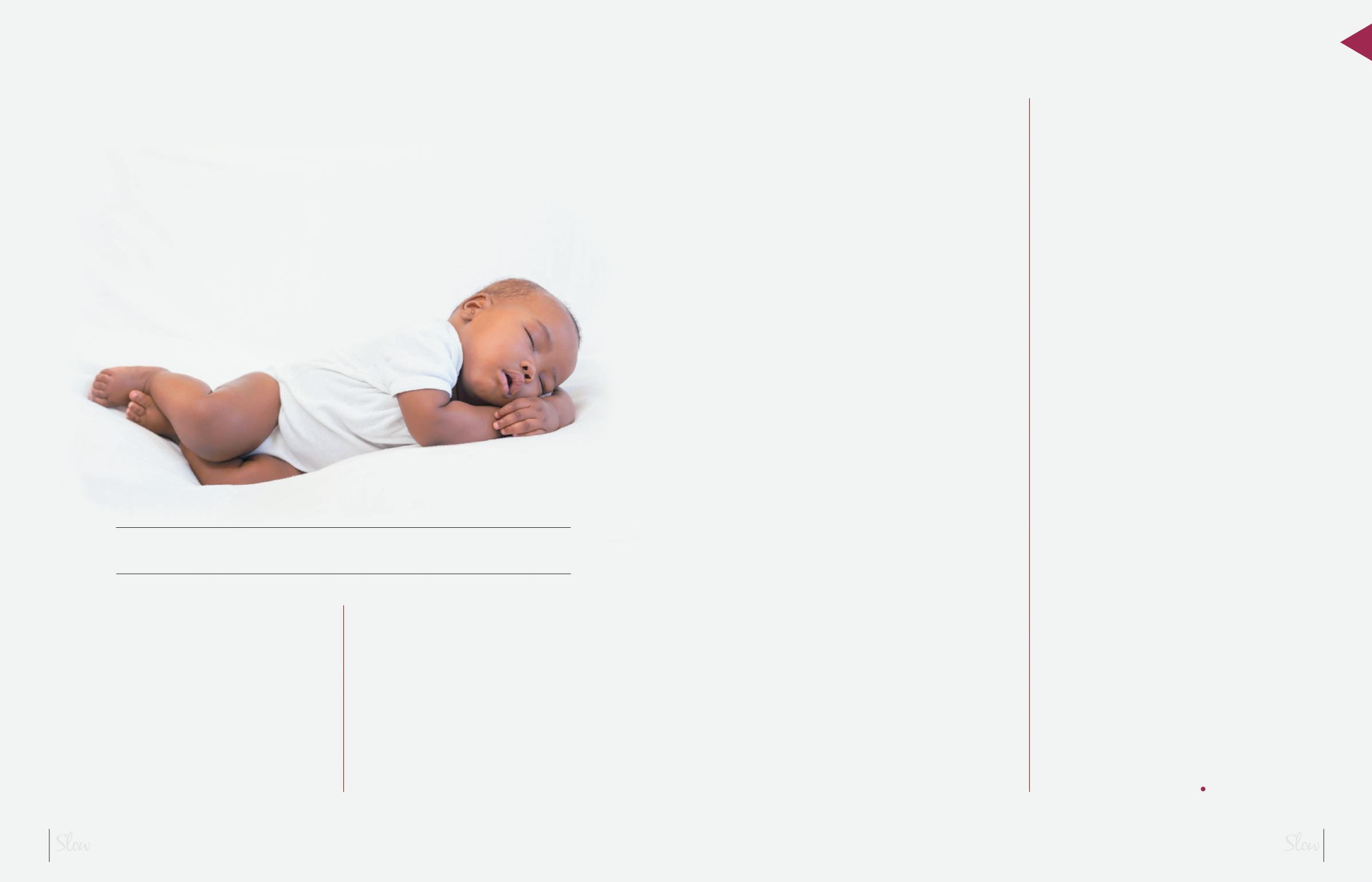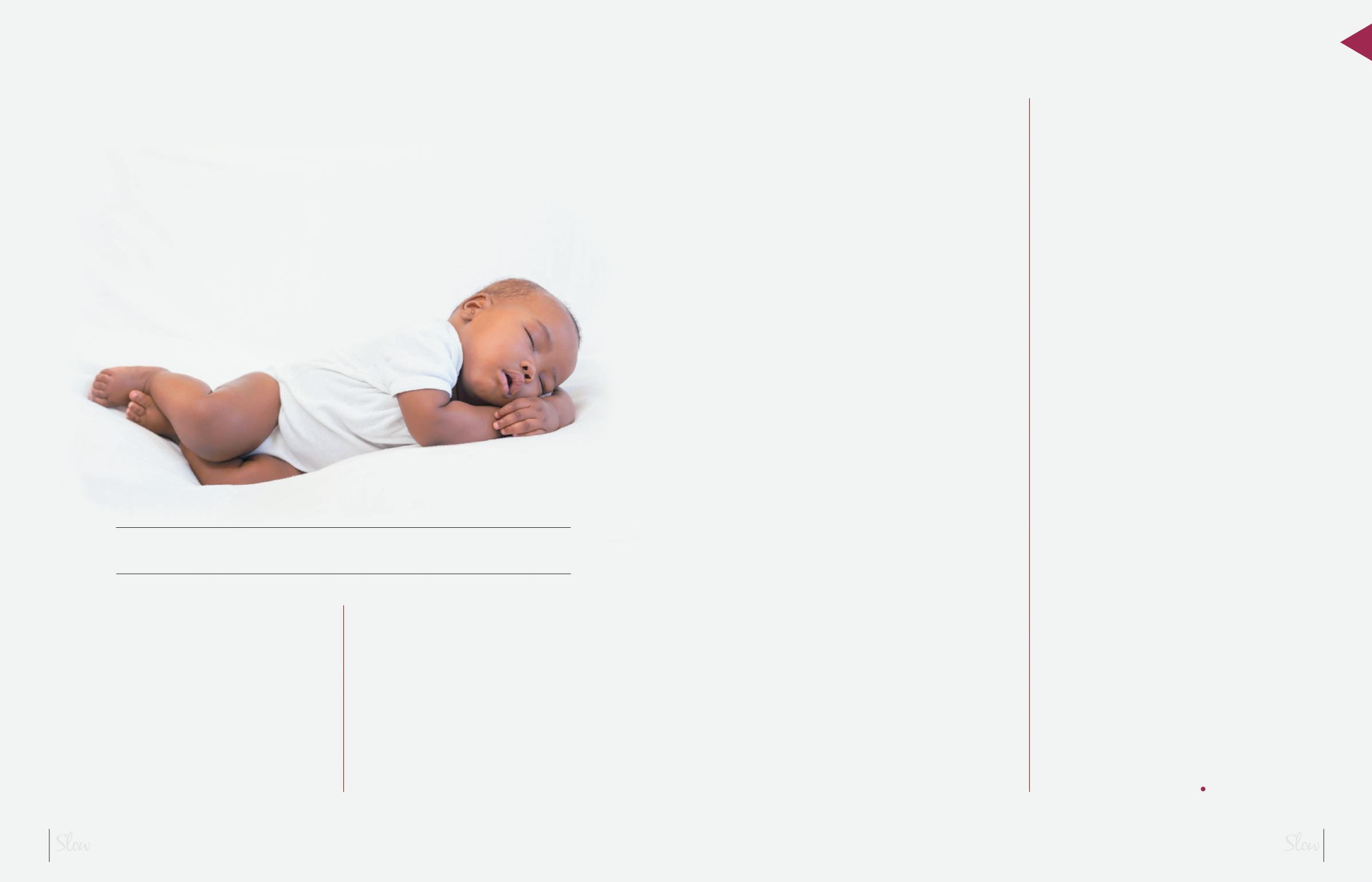
l y a une énigme de la gratuité. Elle émerveille
et trouble à la fois. On a envie d’y croire et
on craint qu’elle soit finalement impossible.
Nombreux sont les jeunes qui privilégient
les postes dans le secteur humanitaire et les
associations philanthropiques. Ils y voient un
surplus de sens. En même temps, on soup-
çonne souvent le bénévolat d’être le lieu
de la frustration et du ressentiment, où les
acteurs se paient en valorisation sociale, en
bonne conscience et autre rétribution cachée,
à défaut d’une rétribution sonnante et trébu-
chante. Le philosophe Derrida remarquait
que le donateur, du moment qu’il prend
conscience de son don, se paye lui-même d’une
reconnaissance symbolique, ce qui ressemble
bien à une valeur marchande. L’échange
marchand serait-il alors plus franc ? Que
reste-t-il du don, du don gratuit ? Existe-t-il
vraiment ? Qu’en est-il du don dans le monde
de l’entreprise souvent enfermée dans sa
dénomination « à but lucratif » ?
Appelons don gratuit le fait de céder librement
un bien à l’autre sans espérance de retour. On
objecte souvent qu’à partir du moment où
il y a retour, il n’y a plus vraiment don. Ne
serait-ce qu’un simple merci de la part d’un
donataire perturberait la gratuité du don fait
par le donateur. C’est une erreur : la gratuité
du don n’exclut pas le bénéfice qu’en retire
le donateur, mais l’intention du bénéfice.
Il y a gratuité quand un acte est fait dans une
intention désintéressée. C’est là un paradoxe
du don : il peut procurer la plus grande des
satisfactions à son auteur, alors même que ce
dernier ne la cherche pas d’abord. La logique
du don s’oppose à la logique commerciale,
comme la gratuité au lucratif. Pourtant, on
fait généralement du lucratif le fondement
de la gratuité comme dans le raisonnement
– juste – suivant : le monde associatif fonc-
tionne grâce aux subventions, dont tout le
monde sait que ce sont
in fine
les entreprises
qui les paient. Jamais il ne vient à l’esprit
que ce pourrait être le contraire, à savoir
que la gratuité puisse fonder le lucratif, ce
qui voudrait dire que le don est antérieur à
l’échange marchand, qu’il est plus réel, et
que c’est lui en définitive le modèle de la rela-
tion de l’être humain au monde et au travail.
Explorons cette voie.
Il en est du don comme de la vie. La vie est
la part donnée de tout être humain. Chacun
a reçu son corps, son nom, ses qualités et
ses défauts, le contexte familial, humain
et culturel dans lequel il voit le jour. Sans
ce capital de départ, il n’est rien. Chacun
est d’abord l’héritier, le terme d’une longue
chaîne de causes infiniment complexes qui a
commencé il y a plus de quatorze milliards
d’années ; il est l’aboutissement de ce que
François Cheng appelle « la grande aventure
de la vie. » Chacun reçoit gratuitement ce
capital infini, qu’il lui appartiendra de faire
sien. Admettons la prééminence originelle du
gratuit dans l’ordre de la vie et de la personne.
Qu’en est-il de l’entreprise ? N’est-elle pas
un îlot technico-scientifique, comme dirait
Comte-Sponville, qui l’exclut à tout jamais
des rives de la gratuité ? Osons pourtant
continuer d’explorer cette voie. La recherche
de profit est certes aux antipodes de la gratuité.
Elle concerne un avantage qui résulte d’une
activité. Ce qui veut dire que le profit n’est
jamais un objectif au sens strict, mais la consé-
quence (heureuse) de la poursuite d’un objectif.
On parle à juste titre d’un revenu, c’est-à-dire
de ce qui revient à quelqu’un qui a exercé une
activité avec succès. Le profit a beau être le but
recherché par l’actionnaire (même s’il peut
exister des actionnaires qui ne le recherchent
pas en premier), il n’en reste pas moins que
le fondement de l’entreprise économique est
la valeur ajoutée qu’elle produit, achetée par
un client. Or la production de valeur ajoutée
est rarement intégralement rétribuée. C’est
évident pour les professions « libérales »
puisqu’un médecin qui sauve un patient d’une
maladie (mortelle) recevra un honoraire qui
n’a rien à voir avec le service rendu. Comment
rémunérer une vie humaine sauvée ? Mais c’est
aussi vrai du créateur d’entreprise qui crée des
emplois et permet à des familles entières de
vivre correctement, c’est vrai de l’innovateur
qui apporte un nouveau process qui procure
des avantages pérennes à d’autres que lui-
même, c’est vrai du cadre qui donne à son
travail une énergie supplémentaire, c’est vrai
de tout travailleur qui prend à cœur son acti-
vité, qui cherche à la réaliser au mieux, à lui
apporter une qualité, un supplément d’âme.
C’est ici que se déploie le changement de para-
digme. On passe du travail intégré dans le
marché, objet d’échange et rétribué, au travail
désintéressé, procédant d’un sujet qui donne
plus qu’il n’est rétribué. La première sphère
est celle de la nécessité, la seconde celle de la
gratuité. Les deux sont évidemment complé-
mentaires. Mais seule la seconde donne une
satisfaction profonde. Les gens heureux
au travail sont non seulement rémunérés
justement, mais ont le privilège d’investir
de leur propre personne dans leur activité.
Au fond, c’est cela que l’on rêve de décou-
vrir à travers son activité professionnelle :
donner gratuitement de soi-même pour que
le monde progresse. La vocation au travail et
à la transformation du monde comporte bien
une part de gratuité essentielle, rétive à toute
rétribution. C’est que l’homme ne se mesure
pas d’abord à ce qu’il gagne, mais à ce qu’il
donne. Et il souffre de gagner sans donner.
Parce qu’il sait qu’au fond, « tout ce qui n’est
pas donné est perdu » (P. Ceyrac)
La gratuité,
fondement
de la vie
Par
Pierre d’Elbée
Philosophe consultant - Fondateur d’IPHAE Conseil - Associé Caminno
Gratuité du don
n’exclut pas
le bénéfice qu’en
retire le donateur
I
35
humeur
34